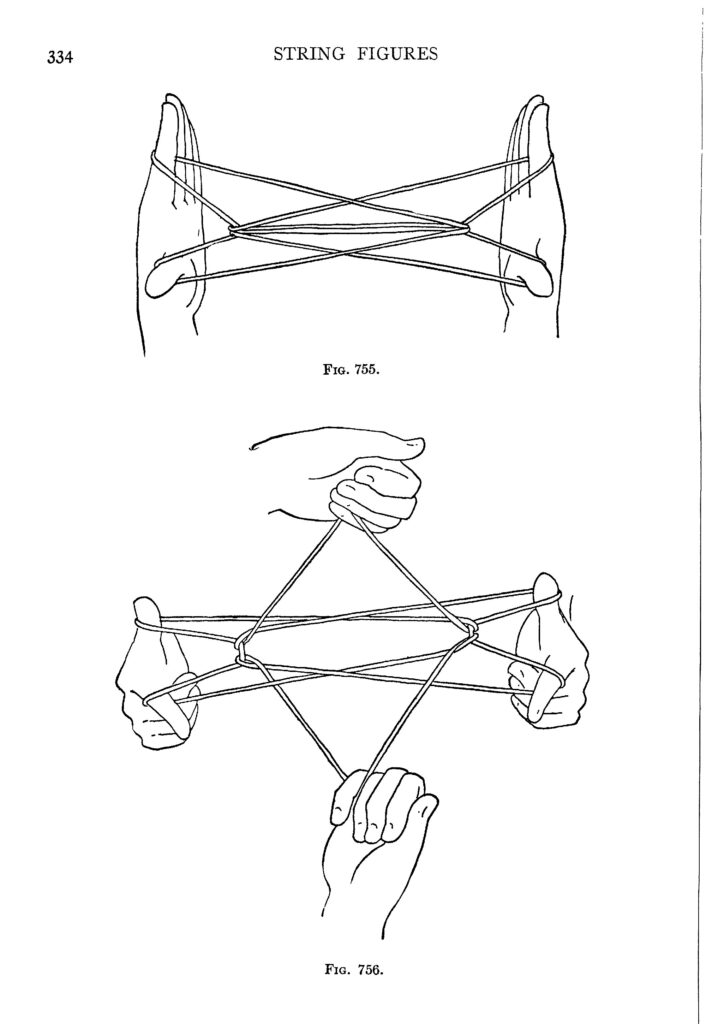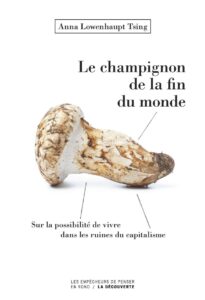Comme j’en ai déjà parlé dans l’article Epaissir le réel, un des objectifs de ce blog est d’aborder les contenus scientifiques sous un angle épistémologique1 (critique des constructions de savoirs) particulier : l’approche des savoirs situés. C’est une approche qui combine sans les opposer à la fois les capacités des sciences à construire des savoirs objectifs, et les aspects sociaux, culturels, subjectifs, qui traversent cette construction de savoir. Il s’agit, en somme, de voir comment assumer ces aspects subjectifs permet de construire encore plus d’objectivité. Si vous voulez voir à quoi cela ressemble concrètement, je vous invite à lire cet article, où j’ai utilisé cet angle de lecture pour aborder le concept de “dominance”.
Cette fois-ci, je vais vraiment essayer de présenter le modèle le plus complètement possible, pour que vous puissiez l’utiliser vous-même lorsque vous abordez un nouveau contenu, en particulier scientifique. Bien entendu, il s’agit d’une perspective qui ne remplace pas, mais complète, la grille de lecture classique, à appliquer à la lecture d’articles scientifiques, comme présentée par exemple dans l’article co-écrit par Geraldine Merry et Anaïs Dethou qui présente notamment le “CRAAP test”. Comme je l’ai dit dans mon premier article, un des grands principes de l’épistémologie des savoirs situés est que c’est en multipliant les décalages, en multipliant les perspectives sur un même sujet (comme lorsqu’on tourne autour d’une statue pour la voir sous un autre angle) qu’on enrichit notre vision, et qu’on en augmente l’objectivité.
Donc, en complément de leur super article, qui développe la façon “interne” à la méthode scientifique expérimentale d’analyser des contenus, je vous propose une autre grille de lecture, plus constructiviste, pour “épaissir le réel”, justement, pour “compliquer” les choses, pour apporter une touche supplémentaire de complexité :
Voilà, normalement, en combinant ces deux approches, j’espère que se dessinera devant vous un monde complexe, où les scientifiques sont des humains, avec leur propre parcours, avec leur propres enjeux, pris dans leur vie familiale, sociale, leurs réseaux d’ami·e·s et de collègues, les complexités de la vie académique, avec ses nécessités de publier, de trouver des financements, de composer avec les collègues, mais qui essaient dans tout ça de construire le plus objectivement possible des savoirs solides, en essayant d’être le plus rigoureu·x·ses possibles, en essayant d’être attenti·f·ve·s à leurs propres biais, en combinant du mieux qu’iels peuvent leur désir d’être objecti·f·ve·s et leurs propres valeurs, pour faire avancer le monde.
- Discipline qui a pour objet l’étude de la construction des savoirs, leurs critères de validité, leurs limites, leurs angles morts ↩︎
- En un mot. Il s’agit d’assumer le fait que les deux sont toujours entremêlés, au point qu’il est absurde et même trompeur de faire une distinction entre les deux. ↩︎
- Invité par Michael Shikashio dans son podcast ↩︎
- Invité par Hannah Branigan, aussi dans son podcast ↩︎
- Bonanni, Roberto, and Cafazzo. ‘The Social Organisation of a Population of Free-Ranging Dogs in a Suburban Area of Rome: A Reassessment of the Effects of Domestication on Dogs’ Behaviour’. In The Social Dog: Behaviour and Cognition, edited by Juliane Kaminski and Sarah Marshall-Pescini. Amsterdam: Elsevier/Academic Press, Academic Press is an imprint of Elsevier, 2014.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407818-5.00003-6 ↩︎ - Je dédierai probablement plus tard un article complet à ces guillemets ↩︎
- Il y a encore seulement 20 ans, quand j’étais aux études, cela fonctionnait comme cela ↩︎
- J’en parlerai certainement encore, mais c’est tout le sens de “vivre avec le trouble”, comme proposé par Donna Haraway : assumer que les choses sont complexes, et qu’il n’existe pas de position éthique qui nous permette d’être tranquilles, à moins de se voiler la face. Et justement, c’est ce petit malaise, ce trouble éthique qui reste toujours dans un coin de nos têtes, qui nous oblige à toujours tenter de faire mieux. ↩︎